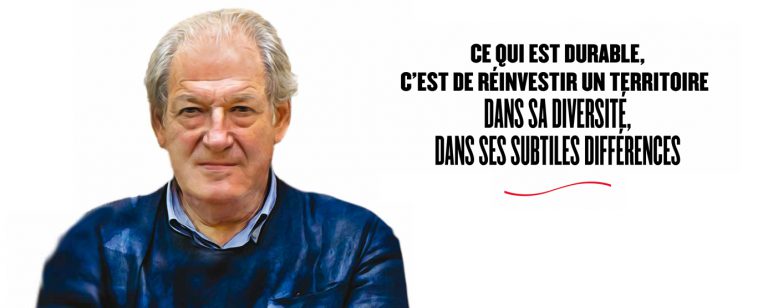Depuis 1975, Alexandre Chemetoff exerce une activité polytechnique dédiée à l’aménagement du cadre de vie. Il compose, projet après projet, une équipe, le bureau des paysages, à la manière d’une troupe dans laquelle les rôles se distribuent en fonction des exigences, du contexte et du terrain, conjuguant urbanisme, paysage et architecture. Avec son expérience de praticien, il réinterroge ici, quitte à la bousculer, la notion même de Ville durable.
La ville durable est-elle un oxymore ?
« Ville durable » est déjà une expression datée, d’ailleurs je ne l’emploie jamais. La Ville durable et son cortège d’écoquartiers, d’immeubles à énergie positive, me font penser aux panneaux qui, à l’entrée des agglomérations, dans les années soixante, en vantaient les mérites. On y voyait le nom de la ville associé à « sa » piscine patinoire, « sa » zone industrielle et « son » grand ensemble. Les écoquartiers sont pour la plupart, une forme contemporaine de nos anciens grands-ensembles. Ils seront sans doute bientôt considérés comme des objets urbains périmés datant de la fin du XXe siècle et du début du XXIe. La ville durable se veut une invitation à produire une ville vertueuse du point de vue de l’environnement et de l’étalement urbain mais elle a un défaut : elle suppose par antiphrase que les autres villes et les autres parties de la ville, ne seraient, elles, ni durables, ni vertueuses.
Or, depuis toujours, denses et agréables à vivre, de Rome à Paris, de San Francisco à New York, les villes que nous aimons, sont durables. Leurs rues où passaient des chevaux, sont aujourd’hui sillonnées par des voitures et parcourues par des vélos. Leurs tissus, y compris ceux des faubourgs, se sont prêtés de façon remarquable aux mutations et aux changements de mode de vie. Depuis longtemps on y pratique des formes durables d’architecture, des anciens entrepôts deviennent des musées et des immeubles d’activité sont transformés en lofts.
Si l’on aborde la question sous l’angle de la consommation d’énergie des bâtiments, c’est autre chose. Il s’agit alors de mesurer des performances, comme on le ferait, s’agissant d’une voiture qui contrairement au logement, est un bien de consommation périssable. Je n’ai évidemment rien contre l’amélioration des performances environnementales, mais la ville est d’abord un enjeu culturel et démocratique. On ne saurait en apprécier les qualités au simple respect d’un cahier des charges, fût-il environnemental. La performance doit-elle devenir l’alpha et l’oméga d’une architecture et d’un urbanisme attentif à l’environnement ? J’en doute, et on ne me fera pas prendre une tour, dont les fenêtres ne s’ouvrent pas, pour un modèle vertueux de la ville durable !
On parle beaucoup de la nature en ville, de l'agriculture urbaine...
Cela pose surtout la question de la campagne. La région parisienne a toujours été productive. Il y avait des maraîchers à Pierrefitte et à Saint-Denis, des pêches à Montreuil, des asperges à Argenteuil. Il ne s’agit pas d’un retour à la « nature » mais d’une démarche culturelle ou culturale, ce qui est à peu près la même chose. N’oublions pas que la campagne nous est indispensable, tout simplement parce qu’elle nous nourrit. Le lien entre ville et campagne est essentiel, c’est une relation fondatrice déterminante. La consommation de terres agricoles pour étendre l’urbanisation est une véritable hérésie, un acte criminel. Il faut réintroduire de la diversité sur les terres, que ce soit pour les cultures vivrières ou l’élevage. Il y a clairement un problème de prise en main de l’équilibre entre ville et campagne à l’échelle régionale. L’intégrité et la qualité du paysage nourricier devrait être un investissement prioritaire de la ville. Il est urgent que les villes veillent sur les campagnes qui les entourent. Mais cultiver des fraises sur les toits des immeubles, c’est au mieux une plaisante distraction, au pire un simulacre, mais certainement pas un substitut.
Quel urbanisme, quelle architecture sont alors souhaitables ?
Il faut travailler partout à partir de ce qui est déjà-là, y compris dans les villes nouvelles. Tous les territoires gagnés par l’urbanisation et en particulier au XXe siècle, devraient être réaménagés en s’interdisant de partir à la conquête de terres nouvelles. Ce qui est durable, c’est de réinvestir un territoire dans sa diversité, dans ses subtiles différences. On ne peut s’abstraire du lieu, des conditions climatiques, du paysage, de l’environnement dans lequel on se trouve. On ne devrait pas construire de la même façon à Marseille, Lille, Strasbourg ou Dijon. Pour le vin, on parle de terroir plutôt que de territoire. Même si le terme paraît un peu « réac », je l’adopterais volontiers s’agissant d’urbanisme et l’architecture. La tentation régionaliste est ambiguë, mais la perte de tout repère provoque une inquiétude que l’on aurait tort de ne pas prendre en considération. Il n’y a pas, de mon point de vue, de projets qui puissent s’abstraire de l’histoire, de l’existant. Tout, alors, est une question de transmission et d’héritage. À Marne-la-Vallée, il serait intéressant de remettre les pas dans les pas, revenant sur ce qui a été fait pour le revisiter, le transformer, tirant avantage de toutes les situations pour imaginer de nouveaux habitats. Les grandes emprises de stationnement, les centres commerciaux constituent les ressources de la ville de demain, à partir desquelles il faudrait densifier la ville plutôt que de l’étendre. On peut ainsi se servir de tous les héritages et aussi de ceux de la ville industrielle. Le projet que nous avons réalisé dans l’Île de Nantes, dans les anciennes nefs de la Loire, parcourues par l’éléphant, révèle les mémoires contrastées de la ville, les anciens chantiers navals comme la végétation subspontanée des bords de Loire. La Comédie de Saint- Etienne s’est installée dans une ancienne usine. Une école, une crèche et des ateliers ont été aménagés dans la Manufacture d’armes désaffectée. L’Agence d’urbanisme de Nancy a pris place dans les anciennes écuries des abattoirs. À Bègles, la Cité numérique se glisse dans les murs du centre de tri postal en métamorphosant un bâtiment de 25 000 m² construit en 1978. Ce qui est intéressant dans ces exemples, c’est de penser la programmation en fonction de chaque lieu. Le dialogue entre le programme, le site et le projet, produit une esthétique de notre temps, à la fois attentive et économe.
Quand on travaille sur sa transformation, le tissu urbain offre une résistance bénéfique. Les riverains, les habitants peuvent par exemple s’opposer à la densification de leur quartier. Mais cette difficulté nous tient éloignés de la tentation totalitaire de toute entreprise idéale qui ferait table rase du contexte et du passé. Les difficultés qu’opposent aux initiatives les lieux et ceux qui les habitent sont salutaires, elles empêchent les solutions les plus extrêmes, favorisant les choix relatifs. La confrontation avec l’existant est une garantie démocratique. La transformation oblige à se poser des questions, l’aménagement devient alors un enjeu culturel. Je le répète, en toutes circonstances et en toute situation, il faut partir de l’existant et, en le revisitant, construire et aménager la ville sur la ville.
- Étiquettes CADRE DE VIE